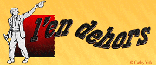
Crée le 18 mai 2002
Pour nous contacter : endehors(a)no-log.org
Comment publier un article sur le site ?
Comment publier un commentaire à un article ?
Charte du site
D'où venons-nous ?
Qui sommes-nous ?
Nos références
( archives par thèmes )
Les éditions de L'En Dehors
Alimentation
Culture
Ecologie
Economie
Editorial
F Haine
Histoire de l'anarchisme
International
L'En Dehors d'Armand
Le privé est politique
Nouvelles du site
Pour comprendre
Projets alternatifs
Social
Technique
Vidéos et audios
colonies et communautés anarchistes

Ephéméride anarchiste
La presse anarchiste

Cartoliste (cartes postales sur l'anarchisme)
Autres liens
Mot de passe oublié ?
|
L'En Dehors
|
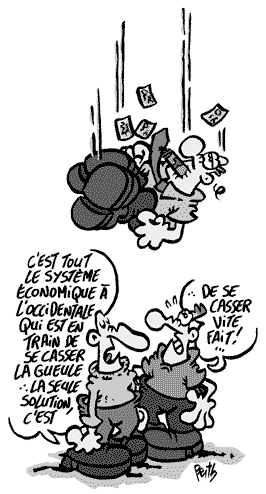 Dans
les pays du Sud, certaines pratiques sociales vont au-delà de la simple
lutte contre la pénurie et s’apparentent à une résistance et/ou une
alternative au modèle occidental. Parlez-nous des intuitions qui vous
ont poussé à explorer ces territoires-là.
Dans
les pays du Sud, certaines pratiques sociales vont au-delà de la simple
lutte contre la pénurie et s’apparentent à une résistance et/ou une
alternative au modèle occidental. Parlez-nous des intuitions qui vous
ont poussé à explorer ces territoires-là.
Serge Latouche : Je suis allé au Congo en 64. À l’époque, on pensait que la révolution viendrait du Sud. Mao disait « le vent d’Est est plus fort que le vent d’Ouest ».
Évidemment, je n’avais aucune idée de ce qu’on a appelé plus tard le
secteur informel. Tout le pays était désarticulé suite à la guerre. La
région de Kinshasa était isolée, à l’abandon. Les gens se
débrouillaient. Il y avait des activités dynamiques d’artisanat,
d’agriculture urbaine. La nature est généreuse, il n’y avait pas de
grosse pression démographique, la bouffe était facile à assurer. Il y
avait même une certaine prospérité. Mais je ne l’avais pas théorisé.
C’est dans L’occidentalisation du monde, en 1989,
que j’ai exposé une conception autre que celle du marxisme : le
développement est une forme d’occidentalisation du monde et il va vers
la faillite. La solution n’est pas que le tiers-monde se développe,
c’est qu’il invente ou réinvente un après-développement. Et ils sont
condamnés à le faire, puisque le développement ne leur laisse que des
ruines. Ils sont condamnés à se débrouiller dans des conditions
difficiles. Et ils y arrivent, car en Afrique les structures sociales
de solidarité ne sont pas complètement détruites. Il y a une créativité
extraordinaire aussi bien au niveau du lien social qu’au niveau de
l’imaginaire. Entre les enfants-soldats, les pandémies, les massacres,
les famines, etc., on pourrait dire : la vie n’a pas de sens. Mais il y
a toujours cette capacité à créer de la joie de vivre. Ce qui rend
possible cela, c’est que les gens sont bien enracinés dans le monde à
travers, par exemple, cette production de sens que sont les mouvements
prophétiques. À Lagos s’est créé, il n’y a pas si longtemps, un
syndicat de prophètes vivants. Puis j’ai étudié l’auto-organisation
sociale au Grand Yoff, à Dakar. J’ai rencontré un Sénégalais, Emmanuel
N’Dion, qui était allé là-bas en pensant qu’il apporterait quelque
chose aux gens. Et ce sont les gens qui lui ont apporté. Il a écrit un
bouquin qui s’appelle Dynamique urbaine d’une société en grappe.
Il a compris que tout fonctionnait à travers des réseaux néo-claniques.
C’est une dimension que jamais un économiste ne considère. Pourtant, on
ne peut pas comprendre la « réussite » de ce qu’on appelle l’économie
informelle sans voir toute cette base imaginaire et sociologique. Ce ne
sont pas des petits entrepreneurs qui se développent d’une manière
individuelle dans un monde individualisé.
Et ailleurs qu’en Afrique ?
J’ai aussi été au Laos. J’y ai fait la comptabilité nationale en 1970.
À cette époque, je croyais à l’économie planifiée, au développement
sous une forme socialiste. J’évaluais la production familiale,
villageoise. Les statistiques étaient totalement fantaisistes : puisque
le pays n’exporte rien, c’est donc un pays misérable. Je me suis aperçu
qu’on pouvait faire dire n’importe quoi aux chiffres.
Pensez-vous qu’il y a dans la société occidentale des défiances, ou une possible résistance vis-à-vis de la croissance ?
Ah, oui ! Mais la prise de conscience est diffuse. Certains disent
c’est détraqué, mais ne remettent pas en question l’idéologie du
progrès. Quand ATTAC, entre autres, reprend ce truc du développement
durable, ils se foutent de nous.
Certains disent que la décroissance serait un retour en arrière, vers des localismes néo-féodaux, pré-capitalistes.
Les rapports sociaux, ils seront ce qu’on en fera, mais de toute façon
la relocalisation, même sans décroissance, est inéluctable. Quand le
pétrole sera à 150 $, et ça pourrait bien être après-demain, la vie
sera relocalisée, de façon féodale ou de façon conviviale. Et puis, la
démocratie n’est possible que localement. « Démocratie mondiale »,
c’est une contradiction dans les termes. La renaissance du local, c’est
une occasion de repenser la démocratie. Bien sûr, le local, dans le
système actuel, c’est le lieu des magouilles, mais le mondial aussi...
Vous parlez de simplicité volontaire...
Mais en Afrique, la flambe, la dépense, le don, sont des moteurs
essentiels de la dynamique sociale. Certains « anti-croissance »
mettront ces attitudes-là sur le compte de l’influence occidentale...
Vont-ils inviter les Africains (ou les banlieusards d’ici) à « courir tout nus à travers champs avec un verre d’eau à la main » ?
Je me méfie de l’austérité. Mais il ne faut pas que la dépense
compromette la survie de la société. Il faut trouver des formes
« d’orgie » qui ne passent pas par l’exploitation. C’est possible,
puisque ça a existé dans beaucoup de sociétés.
Cette nostalgie d’une vie frugale,
n’est-ce pas en partie une production mentale de classes moyennes en
proie à la mauvaise conscience ?
La mauvaise conscience
européenne a de justes fondements. Mais ce n’est pas en se flagellant
qu’on fait avancer le schmilblik. Nous avons un devoir d’exemplarité.
Ceux qui entrent en dissidence doivent montrer que l’on peut construire
un autre monde, non pas parce qu’il n’y a plus de gâteau, mais parce
qu’il est empoisonné, comme dit Nietzsche. L’austérité matérielle
n’exclut pas une orgie de biens relationnels, de joie de vivre.
Est-ce que la braderie des services
publics peut être vue comme une chance historique de récupérer
socialement les activités qui étaient exercées par l’État ?
Je
suis très attaché au service public. Il faut le défendre bec et ongles.
Même s’il faut aussi le critiquer. S’il n’y a plus de services publics,
ce ne sera pas l’enfer, on se débrouillera. On redécouvrira peut-être
même des aspects positifs. Mais je ne pense pas qu’il faille souhaiter
la fin de la Sécu. Bien sûr, la médecine détruit la santé, elle
engendre des maladies qu’elle ne résout pas. De même pour l’école, qui
est une véritable catastrophe. Mais on la défendra jusqu’au bout, et
quand il n’y en aura plus, ça sera l’occasion d’inventer autre chose.
Vous dites que dans la perspective
d’une décroissance non imposée, le marché et le profit pourraient
persister comme incitateurs...
Ça fait mal aux anars, ça. Je
n’ai pas dit le marché, mais les marchés. J’oppose le marché (le
mécanisme économique abstrait) et les marchés. Les marchés, ce sont des
lieux de sociabilité où on procède à des échanges, de manière
différente qu’au sein de la famille ou du clan, mais avec le même
esprit. On échange même avec ses ennemis. Et la première chose qu’on
échange, ce sont des paroles. Ce sont des lieux où l’économique est
enchâssé dans le social. Bien sûr, il n’est pas question d’échanger à
perte, mais la motivation du profit n’est pas obsessionnelle. Alors,
dire qu’il faut abolir l’argent, l’échange marchand, le salariat...
J’ai essayé de faire fonctionner des coopératives, il y a des gens qui
préfèrent être salariés. Ce n’est pas pareil d’être salarié dans une
société libre que dans une société fondée sur l’exploitation. C’est
difficile à faire comprendre aux camarades anarchistes parce qu’ils ont
fétichisé les concepts : le capitalisme, l’argent, le salariat, le
profit, c’est l’ennemi. Donc il faut les abolir. Oui, mais comment on
fait, concrètement ? On va le décréter ?
On peut douter que le super-pouvoir des multinationales disparaisse petit à petit, faute de clients...
Oui, mais comment l’abolir ? Le seul espoir, c’est qu’elles se détruisent elles-mêmes. Et elles sont bien parties pour.
Vous avez parlé de pédagogie des catastrophes...
On va droit dans le mur et il y a deux forces qui peuvent nous mouvoir.
Il y a l’idéal : l’homme est possédé, même le plus cynique, par des
aspirations qui le travaillent. Vous n’imaginez pas le succès de la
décroissance parmi les chefs d’entreprise. Un patron avec six cents
employés, ce n’est pas la méga-machine, ça reste à un échelon où le
type se sent responsable. La deuxième force qui fait avancer
l’histoire, c’est le coup de pied au cul. Tchernobyl a poussé les
Italiens à renoncer au nucléaire. La vache folle a marqué les habitudes
de consommation des Français. Le système engendre des catastrophes. Ce
qu’on a vu n’est rien comparé à ce qu’on va voir. Quand on parle de
sixième extinction des espèces, l’homme, qui en est l’acteur, pourrait
en être aussi la victime.
Et la lutte des classes ?
Elle
est plus présente que jamais. Il y a une polarisation des
contradictions sociales. Mais il n’y a pas de prolétariat conscient et
organisé. Il y a bien antagonisme, mais pas les conditions d’une
révolution telle qu’on la concevait au XIXe. En revanche, il y a celles
d’un effondrement du système. Il n’y aura pas prise de pouvoir mais
réouverture de l’histoire et réinvention d’autres formes d’organisation
sociale à partir des restes. Je travaille à la construction d’une
société de décroissance : comment se réorganiser, se réapproprier
l’argent, articuler les dissidences, s’inspirer des auto-organisations
du Sud.
Comment regardez-vous la délinquance ? Comme une économie informelle ou comme une concurrente de l’activité capitaliste ?
Ah, j’ai vu que vous préconisiez la reprise ndividuelle... J’ai la
chance de mener ma barque assez bien pour être à l’abri du besoin, inch
Allah. Et quand je vois les gens en galère, je me dis qu’à leur place
je casserais une bijouterie. Mais je ne vois pas ça comme une économie
informelle. On a tendance à mettre dans l’informel un peu tout et
n’importe quoi. La drogue, l’économie du crime, etc. Ce qui m’intéresse
c’est l’auto-organisation des exclus se prenant en charge
collectivement pour assurer la vie et la survie. J’idéalise peut-être
en pensant que dans les expériences africaines que j’ai vues, les gens
étaient foncièrement honnêtes. Mais si vous allez au Grand Yoff dire
aux gens qu’ils sont des marginaux, ils vous regardent avec de grands
yeux. La société d’exclus est pour eux la société normale. C’est pour
ça que le jour de la catastrophe, ce sera plus dur pour nous - on a
perdu cette capacité à créer du lien social, à se prendre en charge -
que pour eux. Voilà ce qui est intéressant dans les Systèmes d’échanges
locaux, même si ça fonctionne mal dans la pratique. Là, la délibération
collective s’interpose au cœur du mécanisme économique, qui devient un
mécanisme social. Quand on est dans la merde, ou bien il y a le petit
(ou grand) chef qui prend le pouvoir et qui impose sa loi, ou alors on
se réunit autour de l’arbre et on discute.
Propos recueillis par Nicolas Arraitz et Gilles Lucas
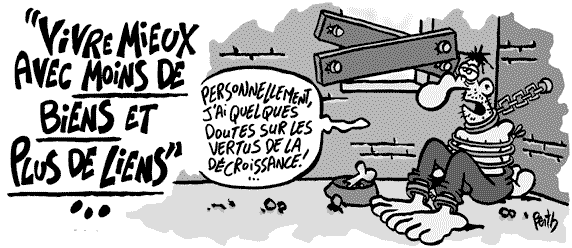
L’informel près de chez vous
Dans les années 60, beaucoup d’intellectuels se tournèrent vers le tiers-monde, alors en voie de décolonisation. « Le vent d’Est [était] plus fort que le vent d’Ouest », comme le rappelle Serge Latouche. Le remplacement des colonies par une myriade d’États nationaux, certains d’obédience stalinienne, a modernisé et maintenu la tutelle des anciens maîtres, et de quelques nouveaux non moins puissants. Aujourd’hui, ce n’est donc plus la révolution qu’on y admire, mais des modes de vie regardés comme autant de résistances aux pressions modernes de la désocialisation. L’herbe était - et reste - toujours plus verte ailleurs [1]. En effet, quel regard autre qu’ethnologique trouve-t-on à propos de l’économie informelle, en Europe et en France chez les analystes et critiques, même les plus avancés dans leur déplaisir vis-à-vis du fonctionnement du monde ? Parce que de l’informel, il y en a évidemment ici aussi. À ceci près que la doxa lui prête des tares qu’elle n’attribue pas aussi systématiquement ailleurs. L’économie informelle en Europe, quand elle ne concerne pas quelque expérimentation groupusculaire, est toujours affublée des qualificatifs « criminelle », « mafieuse », « noire », etc. Ces mêmes adjectifs qu’utilisent d’ailleurs les États du Sud, en accord avec le FMI, pour parler des modes « d’auto-organisation de la vie et de la survie » qui se sont développés chez eux.
L’économie informelle est toujours illégale, en Afrique comme ailleurs, pour la simple raison que les États n’en perçoivent aucune fiscalité. Son fonctionnement se déroule de fait en dehors d’une société régulée par la gestion économique d’une fausse collectivité « nationale », du mouvement frénétique de marchandises éphémères, hors des fondamentaux juridiques et de la hiérarchie officielle des pouvoirs. En France, l’économie informelle se compose de multiples activités : mise en esclavage d’une population étrangère et illégale, travail au noir... Mais dans un grand nombre de cités de banlieue, cet informel est organisé autour d’une circulation intensive de marchandises « récupérées » ou « tombées du camion », et de petits trafics en tout genre [2]. Elle permet de « vivre et survivre ». Mais il est pourtant convenu de parler exclusivement de « criminalité » et de « délinquance ». La presse se régale à ne décrire des banlieues que « tournantes », « gangs », « règlements de comptes », « incendies de voitures », etc.
Ces concentrations de population à bas revenus ou en
situation précaire dans des zones à l’écart, créent des liens, et aussi
des conflits, qui ne sont pas essentiellement différents de ceux qu’on
apprécie dans l’hémisphère sud. Et l’existence, vaille que vaille, de
tels liens est chose rare en Europe. C’est ce qui en fait une menace [3], mais aussi une force. Le film de Bertrand Tavernier, De l’autre côté du périph’,
en présente sans apologie ni romantisme une réalité humaine et
chaleureuse bien éloignée du silence consensuel ou des cris d’effroi
qui entourent ce que l’État appelle à juste raison des « zones de
non-droit ». Dénomination qui recouvre bien plus que les jets de
pierres que reçoivent parfois les patrouilles de police. Cet informel
labellisé « délinquance » n’inspire qu’un désir de l’éradiquer, ou au
mieux de la compassion et laisse de toute façon ces pratiques dans un
isolement contribuant à une hostilité réciproque. En 1995, Bourdieu
avait eu cette audace minimale d’apporter son soutien au mouvement des
grévistes, alors même que les intellos de télé, philosophes de la
connivence, carriéristes de la critique, s’acharnaient sur ces
« privilégiés corporatistes » pourtant engagés dans la plus grande
grève depuis 1968. Sur l’informel massif qui entoure les villes, le
silence des intellectuels-critiques et des porte-voix professionnels
reste assourdissant.
G.L.
ARTICLE PUBLIÉ DANS LE N°21 DE CQFD, MARS 2005.

[1] Le soutien international au mouvement zapatiste, malgré la grande nouveauté de ses propos et de ses stratégies, n’aura pas dérogé à cet adage.
[2] Un commissaire des quartiers Nord de Marseille a reconnu que le supermarché Carrefour situé au cœur de la zone était rentable en grande partie grâce à l’argent « informel » que génère notamment le trafic de haschich.
[3] Les RG ont focalisé une bonne part de leurs services sur les banlieues, Sarkozy a créé les Groupes d’intervention régionaux pour mener la guerre à l’informel.
Commentaires :
|
johan |
volés pillés brûlésDeux choses.
UN, je vois mal comment l'exploitation du travail de l'autre pourra se résorber (même raisonnablement - sic) tant que le hiérarchisme, les privilèges, le profit sur le dos de ceux qui consomment et la plus-value faite sur le dos de ceux qui travaillent, qui sont souvent les mêmes, ne sera pas résolu d'une manière ou d'une autre en se réapropriant l'économie de manière horizontale. Certes on peut compter sur un hypothétique chaos économique qui ferai que les multinationales se cassent la gueule toutes seules et que les petits patrons qui eux sont gentils consentent à faire du petit profit et de la petite exploitation, tandis que nous nous ferons gentillement voler et utiliser. Est-ce plus utopique que de vouloir supprimer l'exploitation (donc le salariat), l'économie marchande (donc l'argent spéculatif, ou l'argent tout court) et accessoirement la destruction de l'environnement génératrice de profit et de croissance, puisque des accidents et de la destruction environnementale ça rapporte (c'est comme une bonne guerre et hop, l'économie repart, c'est pareil pour les catastophes et accidents écologiques). Sauf que l'environnement à des capacités de renouvellement limitées que les abus réduisent toujours plus (le bois, les forêts, les sols, les sous-sols...). Deux, l'économie informelle en occident c'est bien joli, mais ça ne remets en rien en cause les modes de production et certainement pas de consommation (c'est du petit commerce de proximité avec toujours des petits voleurs et des petits payeurs), la simili égalité c'est qu'on fait ça entre nous, ça paraît plus convivial, d'autant qu'on ades prix, mais ça n'enlève rien au principe, c'est pas de l'autogestion, c'est juste de la débrouille. L'avantage étant d'avoir accès à des moyens "culturels et techniques" plus aisément. Mais si il faut attendre que le "Gros" (pas le petit) capitalisme s'effrondre par lui même pour que le petiti s'installe.... Mais concrêtement, ces appareils électronique sont toujours fabriqués de la même façon, avec une durée de vie et une réparabilité quasiment nulles. Par contre les montagnes d'ordures tout le monde en profitera, vive les métaux lourds pour les crevards et vive le recyclage du reste pour les boîtes qui auront réalisé qu'une fois toutes les ressources géologiques, en minéraux et en combustibles fossiles seront épuisées, il faudra bien apprendre à réutiliser ce qui a déjà été extrait à la surface. Tâche pas forcément aisée selon la manière dont sont produits les "biens" de consommation. Mais bon là le capitalisme aura très certainement repris le visage humain du petit commerce et de l'artisanat du moyen-âge. Mais bon nul n'est prophète en son pays (ni sur son continent) alors on va s'émerveiller des vertus de la débrouille sur un autre continent, lui déjà ravagé, écologiquement, géologiquement, bref à la surface et dans son sous-sol, où le capitalisme à déjà apporté le chaos par l'exploitation de tout ce qui pouvait créer du profit, humains et environnement. En espérant vivre comme ça un jour... ? Repondre a ce commentaire
|
|
simon 12-07-05
à 20:04 |
Re: volés pillés brûlésjohan, c'est pas de leur faute en afrique si ils font de la débrouille, pareil dans certaines banlieues mais aussi campagnes françaises. si on s'organise plus, alors ça ne sera pas que de la débrouille.
désolé de mettre le lien partout, mais à ce niveau une alternative se lance (c'est tout nouveau), toutes les infos sont sur www.reclaimyourwork.org ce reseau permet de s'entraider pour se mettre à travailler à son compte (sans patrons, ni salariat), le tout avec une éthique anticapitaliste et décroissante. Repondre a ce commentaire
|
|
Anonyme 12-07-05
à 22:30 |
Re: Re: volés pillés brûlésNi salariat? Cela voudrait dire qu'il n'y a plus de propriété privée et aussi d'argent! Le capitalisme a cette faculté d'englobé tous les membres participant à la production et aussi la société meme, elle a besoin du concours de tout le monde! Avant le capitalisme il n'y avait pas de salariat; en effet cela s'appelait l'esclavage!
Plus besoin de vendre sa "force de travail (intellec ou physique) puisqu'on ne la détient pas... Pour l'organisation en Afrique et partout: je pense que le capitalisme ne peut détruire tous les liens sociaux: (c'est juste un "opera-bouffe" avec morts!!), meme il en a besoin pour se maintenir; je ne pense pas à la soupape de la religion ou de la democratie parlementaire (amenée par le libéralisme!). Le tout dernier lien étant LA CHARITé! Ouf il nous reste un peu de solidarité!!! D'ailleurs si l'on y regarde de pres tous les échanges ne sont pas marchands: les dons/ contre-dons par exemple... Ainsi c'est pourquoi Latouche oppose le Marché (sur la place du village) aux Marchés: lieu de spéculations pures... L'organisation dans un systeme barbare comme le neo-liberalisme se fait d'elle meme... on est humain! est l'etre humain est social.... Rapellez-vous que les voleurs huilent le systeme (a leur façon...) Repondre a ce commentaire
|
|
johan 13-07-05
à 09:48 |
l'exploitation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleursj'ai bien noté les liens qui semblent prôner la posibilité de changement par l'exemple, c'est bien. Juste pour me dédouaner, je ne vois pas en quoi c'est une "faute" de se débrouiller, c'est juste comme ça. Je ne suis pas certain par contre que ça disolve ou résolve les rapports marchands de domination, vendeur/acheteur, possédant/possédé. Après l'intervention qui suit souligne le lien qui existe par ce commerce, n'est-ce pas ce commerce qui se calque sur ce lien, son "fonds de commerce" en quelque sorte, son réseau d'influences.
À mon avis il ne faut pas tout mélanger, je n'ai jamais vu un recel de matériel électronique se transformer en expérience coopérative ou en réseau de solidarité, du moins pas par chez moi, et mon propos était de poser la question des rapports de production, qui fabrique pour quelle demande et non pas quelle offre établi des prix en fonction de la demande. Le système marchand, même à petite échelle est basé sur le profit, donc incite à l'exploitation. Pour moi il ne s'agit pas d'abolir toute propriété privée, la propriété d'usage reste essentielle à la garantie de la satisfaction de tes besoins, la création des biens matériels doit d'ailleurs être motivé par la nécéssité, en tout cas la demande à satisfaire ces besoin avant tout. On crée en fonction de la demande, encoopérant, en échangeant et en mutualisant les connaissances, ensemble directement ou à l'intérieur de fédérations de métiers selon le degré de complexité et la rareté de la chose à produire, mais il reste besoin entendu essentiel d'autonomiser et de localiser au maximum la production, ce qui simplifie et rends accessible la maîtrise des savoirs nécéssaire à la satisfaction des besoins élémentaires (en particulier, le logement, la nourriture, le vêtement, l'eau). L'anarchisme reste un principe de fonctionnement basé sur la solidarité, l'entraide, la coopération et pas la main invisible du marché et le bon vouloir des marchands pour qui la satisfaction de leur marge de profit reste l'objectif, le bien être des consommateurs étant le minimum à suggérer et le facteur de leur capacité d'acheter, mais si il existe des acheteurs suffisement riches et bon payeurs, la qualité de la vie des autres ne dépends effectivement que de la charité du marchand. Aucune égalité dans un système marchand. Repondre a ce commentaire
|
à 10:09